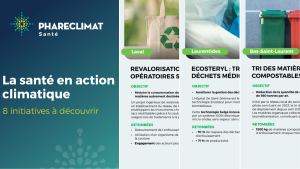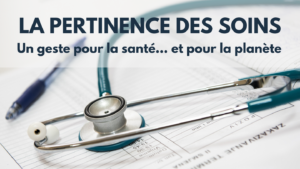Un peu de contexte
Pour atténuer les enjeux du réchauffement climatique, chaque geste compte. Le secteur de la santé à travers la planète, n’est pas en reste et peut contribuer. C’est dans ce contexte que la plateforme PhareClimat Santé et l’Agence Nationale de la Performance médico-sanitaire (ANAP), en France, ont conclu un partenariat promouvant les initiatives communes du secteur de la santé et de l’environnement. À travers l’outil PhareClimat Santé, cette collaboration transatlantique met en lumière des actions concrètes et des innovations qui peuvent être dupliquées au Québec.
1ere initiative : la rationalisation des prescriptions à la maison d’Urfé
L’écoconception des soins repose sur un principe fondamental : éviter le gaspillage dès la source. La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) d’Urfé illustre cette approche à travers la mise en place d’un protocole rigoureux, élaboré en concertation avec l’ensemble de l’équipe soignante, y compris les pharmaciens. En effet, ce protocole vise à ne délivrer que les médicaments strictement nécessaires aux patient.es, en fonction de leurs besoins réels. Cette démarche permet de limiter le gaspillage médicamenteux, d’optimiser les stocks, et de réduire l’empreinte environnementale liée à la production, au transport et à l’élimination des médicaments non utilisés. Sur le plan environnemental, les effets sont significatifs : la réduction de la production de matières premières implique une moindre consommation de ressources naturelles ; les produits non délivrés, ainsi que leurs emballages, ne finissent ni incinérés ni jetés dans les poubelles ménagères des patients ; les flux de transport sont également diminués. Cette sobriété dans l’usage des ressources contribue à une baisse globale des émissions de GES.
Du côté des professionnel.es de santé, cette initiative favorise une amélioration des pratiques pluriprofessionnelles. Elle encourage le travail collectif, valorise l’attention portée aux pratiques des autres métiers, et renforce l’esprit d’équipe. Ce cadre collaboratif donne du sens à l’action quotidienne et facilite la transmission de valeurs écoresponsables aux collègues comme aux patient.es. Les usagers, quant à eux, expriment une satisfaction accrue. Ils perçoivent une attention renforcée à leur santé et à l’impact environnemental de leur traitement. Cette approche permet également d’éviter le stockage inutile de médicaments à domicile, de limiter les risques liés à l’automédication inappropriée, et de sensibiliser les patient.es à une consommation plus raisonnée. Sur le plan organisationnel, les bénéfices sont tout aussi clairs. L’harmonisation du codage de la délivrance des médicaments comparable à un « code de la route » partagé, simplifie le travail des pharmaciens et des infirmiers, tout en réduisant les erreurs de délivrance.
Enfin, d’un point de vue médico-économique, cette démarche permet de réduire les coûts liés à la gestion des déchets (médicaments, emballages, transports), tout en évitant les dépenses inutiles associées à la surconsommation de ressources. In fine, cette initiative met en avant comment concrètement croiser les champs de la santé, de l’environnement et du social, illustrant la réduction des GES et des bienfaits social sur le traitement des patient.es. Si la rationalisation des prescriptions permet d’agir directement sur le terrain, d’autres leviers existent pour intervenir dès la conception des soins. L’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments en est un exemple structurant :
Pour en savoir plus : https://www.anap.fr/s/bibliotheque-idee-recueil-detaille?recordId=a06Jv00000EpZeoIAF
2e initiative : l’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments
Agir en amont, dès la conception des soins, constitue une dimension essentielle de l’écoconception. Dans cette optique, le Ministère de la Santé, la Direction générale des entreprises du Ministère de l’Économie, et le prestataire Ecovamed ont mis au point un guide méthodologique accompagné d’un outil d’autodiagnostic permettant aux professionnel.es de santé d’évaluer l’empreinte carbone des médicaments sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cet outil offre une approche structurée identifiant les principaux postes d’émissions de GES permettant d’orienter les choix vers des pratiques d’approvisionnement plus responsables et durables. Au-delà de la quantification, le guide vise à harmoniser les méthodes d’évaluation en s’appuyant sur les standards internationaux tels que le GHG Protocol et les normes ISO 14040, 14044 et 14067. Il intègre des facteurs d’émissions par défaut, facilitant les calculs pour les acteurs ne disposant pas de données précises. En outre, cela garantie une cohérence méthodologique entre les évaluations.
De plus, l’initiative prend en compte une large gamme de catégories d’émissions, incluant la consommation d’énergie, l’utilisation de matières premières, la gestion des déchets, les immobilisations, les transports, les émissions fugitives, les achats indirects ainsi que les trajets domicile-travail des professionnels. En mobilisant ces indicateurs, l’outil permet de dresser un diagnostic complet et rigoureux.
Enfin, ce cas d’étude illustre concrètement comment une évaluation méthodique et structurée peut devenir un levier d’action, en orientant les décisions vers des bénéfices environnementaux mesurables et des gains économiques tangibles. Au-delà des outils d’analyse, certaines innovations s’intègrent directement dans les gestes cliniques. L’exemple du CH Grace de Monaco illustre comment une approche thérapeutique concilie l’efficacité médicale et la sobriété environnementale.
Pour en savoir plus : https://www.anap.fr/s/article/empreinte-carbone-medicaments
3e initiative : pose de chambre implantable sous hypnose
L’innovation durable peut s’inscrire directement dans les gestes cliniques. Au Centre Hospitalier (CH) Grace de Monaco, l’introduction de l’hypnose dans la procédure de pose de chambre implantable illustre parfaitement cette démarche. En supprimant la sédation, les bénéfices sont multiples : les patients vivent l’intervention avec moins de stress, récupèrent plus rapidement, et peuvent regagner leur domicile dans un délai plus court, contribuant à améliorer leur expérience globale. Pour les équipes soignantes, la technique devient plus simple à mettre en œuvre, plus rapide et plus efficace.
Sur le plan environnemental, cette approche permet une réduction notable de l’impact écologique de l’acte médical. Les dispositifs médicaux sont sélectionnés avec précision, en fonction des besoins réels, diminuant leur empreinte carbone évaluée par une analyse de cycle de vie (ACV) simplifiée, et limitant la production de déchets.
Également, le nombre de dispositifs à stériliser est réduit, entraînant une baisse des émissions liées à la stérilisation. Un protocole de tri des déchets conforme aux dernières recommandations a été mis en place, permettant de diminuer les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). En complément, l’échographe nécéssaire à la réalisation de l’initiative consomme moins d’énergie que les seringues auto-pousseuses habituellement employées pour la sédation. Ce faisant, l’absence de sédation évite aux patient.es un déplacement supplémentaire pour une consultation pré-anesthésique, réduisant ainsi les émissions liées au transport.
Sur le plan économique, les effets sont significatifs. Le nombre de dispositifs médicaux utilisés est réduit, diminuant les coûts d’achat. Le temps d’occupation des blocs opératoires est raccourci grâce à une technique plus rapide et à l’absence de sédation, permettant une meilleure rotation des patient.es. D’autre part, moins de personnel.le est requis sur la procédure, optimisant ainsi la répartition des ressources humaines. De même, les coûts de stérilisation sont revus à la baisse, en lien avec la diminution du matériel à traiter. L’absence de sédation permet un passage direct en ambulatoire, sans recours à la salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), et favorise une libération plus rapide des places.
En somme, cette pratique innovante conjugue efficacité clinique, sobriété environnementale et optimisation économique, tout en plaçant le confort du patient au coeur de la démarche. Ces exemples démontrent que l’écoconception des soins peut s’incarner à différents niveaux du système de santé, qu’il s’agisse de l’organisation, des outils ou des pratiques cliniques. Ils offrent des pistes concrètes pour une adaptation au contexte québécois.
Pour en savoir plus : https://www.anap.fr/s/bibliotheque-idee-recueil-detaille?recordId=a067Q00000CjeLcQAJ
En conclusion
In fine, ces démarches alliant performance, durabilité et bien-être des patient.es, illustrent comment le RSSS québécois peut s’inspirer afin de mettre en place des actions similaires. Avec le soutien des conseillers cadres et autres experts à la qualité des soins, et la mobilisation des profesionel.les de la santé et la collaboration interétablissement, il est possible d’intégrer des modifications aux pratiques de soin afin de réduire l’empreinte environnementale du système de santé québécois. De surcroît, ces exemples outre-atlantique nous rappellent le concept de santé planétaire où la santé humaine de notre planète n’a pas de frontière.